En attendant le Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012, je poursuis mes critiques de classiques du cinéma américain après "Johnny Guitar", "La Comtesse aux pieds nus", "Casablanca" et "Gatsby le magnifique".
Une fièvre (non) nommée désir...
« La fièvre dans le sang » un film de 1961 est un film que j’apprécie tout particulièrement notamment parce qu’il transfigure un apparent classicisme à de nombreux égards, et que j'ai donc revu avec plaisir à cette occasion.
Dans une petite ville du Kansas, à la veille du Krach boursier de 1929 et en pleine prohibition, Deanie Loomis (Nathalie Wood) et Bud Stamper ( Warren Beatty) sont épris l’un de l’autre mais le puritanisme de l’Amérique des années 20, l’autoritarisme du père de Bud qui veut que son fils fasse ses études à Yale avant d’épouser Deanie, la morale, et les vicissitudes du destin, vont les séparer…
Le titre original « Splendor in the grass » (Splendeur dans l’herbe) provient d’un poème de William Wordsworth, « Intimations of immortality from Reflections of Early Childhood » qui dit notamment ceci: « Bien que rien ne puisse faire revenir le temps de la splendeur dans l’herbe…nous ne nous plaindrons pas mais trouverons notre force dans ce qui nous reste », ces vers sont repris au dénouement du film , ils reflètent toute la beauté désenchantée par laquelle il s’achève qui contraste tellement avec le premier plan du film qui symbolise tout le désir, toute la fureur de vivre (le film d’Elia Kazan n’est d’ailleurs pas sans rappeler le film éponyme de Nicholas Ray sorti 6 ans plus tôt) qui embrase les deux personnages : un baiser fougueux dans une voiture derrière laquelle se trouve une cascade d’une force inouïe, métaphore de la violence de leurs émotions qui emportent tout sur leur passage.
Si à de nombreux égards et lors d’une vision superficielle « La fièvre dans le sang » peut paraître caricatural et répondre à tous les standards du film sentimental hollywoodien (un amour adolescent, l’opposition parentale, et le caractère parfois caricatural des personnages et notamment des parents, ou encore le caractère caricatural du personnage de Ginny, la sœur délurée et aguicheuse -interprétée par Barbara Loden- ) c’est aussi pour mieux s’en affranchir. Au-delà de ces clichés émane en effet de ce film une fièvre incandescente qui reflète magistralement celle qui enflamme les deux jeunes gens, en proie à leurs désirs qu’une mise en scène lyrique met en exergue. Le désir jusqu’à la folie, la névrose. « La fièvre dans le sang » est d’ailleurs d’une grande modernité par son évocation de Freud et de la psychanalyse. C’est aussi une réflexion sur les relations parents enfants, sur l’acceptation de l’imperfection (des parents autant que celles de l’existence).
De nombreuses scènes rappellent la scène initiale qui résonne alors a posteriori comme un avertissement de la violence passionnelle et dévastatrice : la scène de la baignoire où, comme possédée par le désir, la rage, Deanie jure à sa mère qu’elle n’a pas été « déshonorée », dans un cri de désespoir, de désir, d’appel à l’aide ; la robe, rouge évidemment, tenue comme un objet maléfique par l’infirmière ; la cascade (d’ailleurs dramatiquement prémonitoire puisque Nathalie Wood est morte noyée en 1981, dans des circonstances mystérieuses, en tombant de son yacht appelé … « The Splendour » en référence au film de Kazan), la même que celle du début où Deanie tentera de se tuer ; les regards magnétiques que s’échangent Deanie et Bud etc.
C’est aussi une critique de la société américaine puritaine et arriviste que symbolisent la mère étouffante de Deanie qui l’infantilise constamment (qui craint donc que sa fille soit « déshonorée ») et le père autoritaire (mais estropié ou car estropié) de Bud, un film qui n’aurait certainement pas été possible à l’époque à laquelle il se déroule (la fin des années 1920) et qui l’était en revanche en 1961.
C’est surtout son dénouement qui fait de « La fièvre dans le sang » un grand film, une fin qui décida d’ailleurs Elia Kazan à le réaliser comme il l’explique dans ses entretiens avec Michel Ciment, (« Ce que je préfère, c'est la fin. J'adore cette fin, c'est la meilleure que j'ai réalisée : il y a quelque chose de si beau dans cette scène où Deanie rend visite à Bud qui est marié. J'ai même du mal à comprendre comment nous sommes arrivés à ce résultat, ça va au-delà de tout ce que j'ai pu faire. C'est une happy end, au vrai sens du terme, pas au sens hollywoodien : on sent que Bud a mûri, on le voit à la façon dont il se comporte avec elle, et lorsqu'il prend sa femme dans ses bras pour la rassurer. C'est cette fin qui m'a donné envie de faire le film. »), une fin adulte, une happy end pour certains, une fin tragique, l’acceptation de la médiocrité, le renoncement à ses idéaux de jeunesse, pour d’autres. Je me situerais plutôt dans la seconde catégorie. Un fossé semble s’être creusé entre les deux : Bud a réalisé une part de son rêve et vit dans un ranch, marié. Quand Deanie lui rend visite dans une robe blanche virginale, il la reçoit le visage et les mains noircis, à l’image de ses rêves (certains) déchus. Les regards échangés si significatifs, si dénués de passion (pas sûr ?), où chacun peut y voir tantôt de la résignation, des regrets, de l’amertume, rendent encore plus tragique cette scène, non moins magnifique.
Le départ de Deanie en voiture laissant dans le lointain derrière elle Bud et avec lui : ses désirs, son adolescence, son idéalisme, nous arrache le cœur comme une mort brutale. Celle du passé à jamais révolu. Le gouffre insoluble et irréversible du destin.
C’est donc aussi la fin, et le renoncement qu’elle implique, en plus de la mise en scène lyrique d’Elia Kazan et l’interprétation enfiévrée de Nathalie Wood et Warren Beatty, qui permet de transfigurer les clichés du film sentimental classique hollywoodien.
Avec ce désir amoureux qui meurt, subsiste, malgré tout, un autre désir : celui de vivre. Sans la fureur. Sans la fièvre dans le sang. Peut-être seulement éclairé par le souvenir. Sans se poser la question du bonheur (Quand Deanie lui demande s’il est heureux, Bud répond qu’il ne se pose plus la question). C’est peut-être là le secret du bonheur : ne pas s’en poser la question…
Ce film vous laisse le souvenir poignant, brûlant, magnétique, lumineux, d’un amour idéalisé, illuminé et magnifié par la beauté rayonnante, d’une force fragile, de Warren Beatty (qui n’est pas sans rappeler Marlon Brando dans « Un tramway nommé désir » du même Elia Kazan), et de Nathalie Wood (elle fut nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, en 1962).
Un film fiévreux et enfiévré d’absolu, à fleur de peau, sombre et lumineux, rouge et blanc, d’eau et de feu, enflammé (de désir) et de la splendeur d’un amour de jeunesse. Un film qui a la force et la violence, incomparable, à la fois désenchantée et enchanteresse, d’un amour idéalisé…ou plutôt idéal(iste).
Peut-on se contenter de la médiocrité quand on a connu ou frôlé l’absolu ? Etre adulte signifie-t-il renoncer ? Peut-on vivre heureux sans renoncer à ses idéaux de jeunesse ? Je ne crois pas (mais peu importe hein ! -Laissez-moi mes idéaux, mon intransigeance, non, mes idéaux, de jeunesse.- Et c’est d’ailleurs aussi cette fin déchirante paradoxalement qui me plait tant dans ce film) cette fin nous répond que oui, et à cet égard, elle est loin de la happy end à laquelle nous habitue le cinéma hollywoodien classique.
Elia Kazan, qui passera toute sa vie a essayé de justifier ses dénonciations de metteurs en scène communistes, à la commission MacCarthy, en 1952, par ce film semble aussi critiquer la société américaine et donc aussi justifier ses propres erreurs, comme il tenta de le faire toute la fin de sa vie....
En tout cas, un classique, un poème lyrique et sensuel doublé d’une critique sociale et un portrait de l’Amérique des années 20, à (re)voir ABSOLUment.
Remarque : Dimanche prochain, le ciné-club projettera « Le plein de super » d’Alain Cavalier en sa présence, il viendra présenter le film puis en débattre après la projection.
Filmographie d’Elia Kazan en tant que réalisateur :
Le Dernier Nabab (1977)
Les Visiteurs (1972)
L'Arrangement (1970)
America, America (1964)
La Fièvre dans le sang (1961)
Le Fleuve sauvage (1960)
Un Homme dans la foule (1957)
La Poupée de chair (1956)
A l'est d'Eden (1955)
Sur les quais (1955)
Viva Zapata ! (1952)
Man on a Tightrope (1952
Un Tramway nommé désir (1951)
Panique dans la rue (1950)
L'Héritage de la chair (1949)
Le Mur invisible (1947)
Boomerang ! (1947)
Le Maître de la prairie (1946)
Le Lys de Brooklyn (1945)
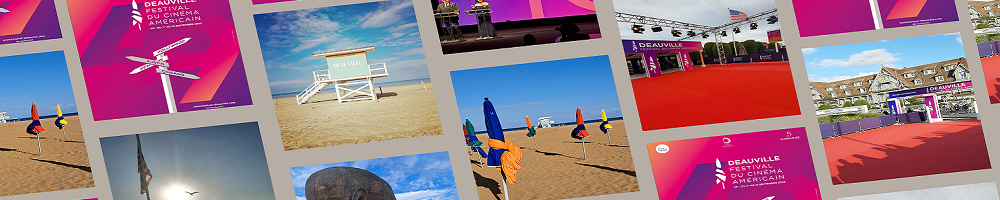




Commentaires
je n'ai pas encore vu ce film (eh oui) mais après avoir lu cette critique, j'ai me laisserais bien tenter :)
stéphanie
Un chef d'oeuvre à voir absolument!