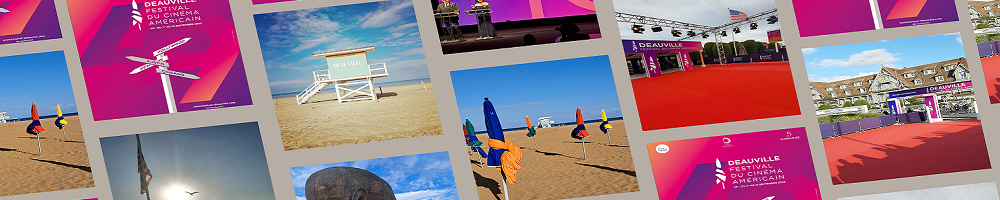- Page 2
-
Il s'agit du cinquième film du cinéaste finlandais qui figurait en compétition du dernier Festival de Cannes.Dans le poste de radio d'un autre âge surgissent les échos d'une guerre si proche, en Ukraine, qui semble tout autant anachronique et pourtant tragiquement contemporaine. Un homme et une femme, chacun dans leur appartement spartiate, écoutent, enfermés dans leur solitude et leur vie précaire, à Helsinki.Avec une économie de mots, un humour burlesque et décalé, un sens du cadre et des couleurs indissociables de son cinéma, Kaurismäki filme l'amour naissant et l'incongruité de chaque moment de vie.Un film d'une drôlerie désespérée, parsemé de références cinématographiques (avec des affiches de Godard, Melville, Visconti...) qui s'achève par un hommage au maître du genre, une fin en écho à celle des Temps modernes.Un film irradié de musiques qui jouent aussi brillamment avec les codes et les contrastes. Encore bercée par la poésie mélancolique de ces feuilles mortes.
-
Critique de L’ENLEVEMENT de Marco Bellochio (L’Heure de la Croisette – Festival du Cinéma Américain de Deauville)

L’Enlèvement de Marco Bellochio fut présenté ce soir à Deauville dans le cadre de la section L’Heure de la Croisette. Une fresque fascinante. Un opéra baroque, tragique et flamboyant, filmé dans un clair-obscur admirable. Mais aussi un plaidoyer contre la folie religieuse et les fanatismes.
En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de sept ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d’Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l’opinion publique de l’Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l’Église et le Pape refusent de rendre l'enfant, pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant...
Ce film a été présenté en Compétition dans le cadre du Festival de Cannes 2023.
Ce film s’inspire d’une histoire vraie, l'affaire Mortara. Edgardo Mortara est né à Bologne en 1851 dans une famille juive. Il est le sixième des huit enfants de Salomone (Momolo) Mortara et de Marianna Padovani. Alors qu'il est âgé d'un an et qu'il connaît un épisode de fièvre extrême, une jeune servante catholique au service de la famille, craint pour sa vie et décide de le faire baptiser en secret. En 1857, les gendarmes de la papauté arrivent chez les Mortara pour arracher l'enfant à la famille pour le conduire à Rome, sur mandat du Saint-Office de l’Inquisition, sous le contrôle direct du pape Pie IX. L’enfant est alors élevé dans la “Maison des catéchumènes et des néophytes” un séminaire créé pour la conversion, entre autres, des Juifs et des Musulmans où il reçoit une éducation catholique rigoureuse et se forme à la prêtrise. Une fois Rome libérée, Edgardo restera malgré tout fidèle au pape. Devenu prêtre, il essaiera jusqu’à la mort de convertir sa famille qui n’a pas voulu renier la religion juive.
Ce qui est passionnant autant que révoltant dans cette histoire, c’est que le mal est commis au nom du bien. Mais aussi la conversion d’Edgardo qui restera fidèle à ses bourreaux, en reniant les valeurs de sa propre famille. Les retrouvailles et la confrontation finale est une des scènes les plus bouleversantes qu’il m’ait été donné de voir au cinéma.
Ces paradoxes se reflètent dans le clair-obscur, l’élégante et brillante mise en scène (avec des scènes qui se répondent magistralement et n’en sont plus que bouleversantes) de Bellocchio qui fait de cette opéra tragique une fresque flamboyante entre le drame, le film historique et le thriller.
Un plaidoyer sublime et saisissant contre l’obscurantisme. Un récit prenant et intense, sublimement reconstitué et passionnant, d’une beauté captivante, entrelaçant intime et politique, histoire et Histoire. Je vous reparlerai plus longuement de ce chef-d'œuvre d'une grande intelligence, beau et profond, qui laisse une forte empreinte.
-
Première - Critique LE RÈGNE ANIMAL de Thomas Cailley
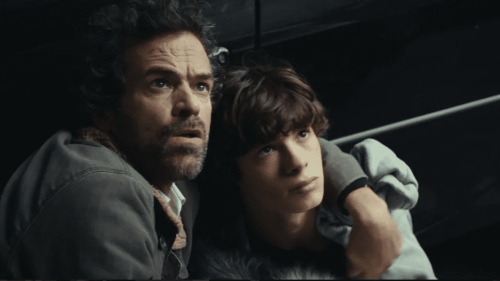
Hier soir, au CID était projeté un film singulier, puissant et saisissant dont vous entendrez forcément beaucoup parler dans les mois à venir, le deuxième film de Thomas Cailley après Les Combattants (César 2015 du meilleur premier film).
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François (Romain Duris) fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile (Paul Kircher), leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.
D’apparence tout d’abord réaliste, le glissement se fait progressif vers le fantastique avec un parallèle évident avec une période récente : celle d’une réalité qui peu à peu s’est transformée en une situation inédite, angoissante et ubuesque qui a arrêté toute la planète. Ce film possède tant de ramifications qu’il faudrait en parler des heures. J’y reviendrai plus longuement. Il est notamment passionnant en ce qu’il questionne cette frontière entre l’Humanité et la Nature. Une manière particulièrement originale d’aborder les mutations du vivant (et donc écologiques) et les risques qui menacent la planète. L’immersion du fantastique dans la vie « réelle » rend le récit d’autant plus universel, en mêlant aussi astucieusement le spectaculaire et l’intime.
Les Landes de Gascogne forment un décor idéal, presque fabuleux, magique, là aussi intemporel, d’une grande richesse et diversité. La forêt devient alors un personnage à part entière, mise en lumière par la magnifique photographie de David Cailley. Ces décors réels dans lesquels a été tournée la totalité du film rendent l’impensable d’autant plus crédible.
Après le Lycéen, Paul Kircher confirme que le cinéma français devra compter sur lui. Son jeu exhale une sincérité et une force rares, sauvages, intense, et la relation complexe avec son père accroissent l’intérêt du film. Et je vous mets au défi de ne pas être bouleversés quand de la voiture, toutes fenêtres ouvertes, s’échappe la musique de Pierre Bachelet tandis que Paul Kircher hurle "maman !". Soulignons aussi le rôle de Fix interprété par Tom Mercier, dans un rôle d’homme-oiseau, de « tout son être, tout son corps. »
Un film atypique, hybride, ambitieux, audacieux intelligemment métaphorique et teinté d’humour. Un récit initiatique et une fable cauchemardesque d’une force rare qui résonne intelligemment avec l’actualité récente mais aussi un fim tendre sur la relation entre un père et son fils. Une auscultation de l’animalité et des mutations de l’homme mais aussi une ode à la différence. Ajoutez à cela une bo absolument magnifique de De Andréa Laszlo De Simone et vous obtiendrez un film d’une grande profondeur derrière un captivant divertissement.
-
Hommage à Natalie Portman - 49ème Festival du Cinéma Américain de Deauville - Critique de BLACK SWAN de Darren Aronokfsy

Natalie Portman ne pouvait être présente pour son hommage, cela ne nous a pas moins permis de revoir le chef-d'œuvre qu'est Black Swan.
Nina (Natalie Portman) est ballerine au sein du très prestigieux New York City Ballet. Elle (dé)voue sa vie à la danse et partage son existence entre la danse et sa vie avec sa mère Erica (Barbara Hershey), une ancienne danseuse. Lorsque Thomas Leroy (Vincent Cassel), le directeur artistique de la troupe, décide de remplacer la danseuse étoile Beth Mcintyre (Winona Ryder) pour leur nouveau spectacle « Le Lac des cygnes », Nina se bat pour obtenir le rôle. Le choix de Thomas s’oriente vers Nina même si une autre danseuse, Lily, l’impressionne également beaucoup, Nina aussi sur qui elle exerce à la fois répulsion et fascination. Pour « Le Lac des cygnes », il faut une danseuse qui puisse jouer le Cygne blanc, symbole d’innocence et de grâce, et le Cygne noir, qui symbolise la ruse et la sensualité. Nina en plus de l’incarner EST le cygne blanc mais le cygne noir va peu à peu déteindre sur elle et révéler sa face la plus sombre.
Black swan »n’est pas forcément un film d’emblée aimable (ce qui, pour moi, est une grande qualité quand les synopsis des films ressemblent trop souvent à des arguments marketing) : il se confond ainsi avec son sujet, exerçant tout d’abord sur le spectateur un mélange de répulsion et de fascination, entrelaçant le noir et le blanc, la lumière (de la scène ou de la beauté du spectacle, celle du jour étant quasiment absente) et l’obscurité, le vice et l’innocence mais le talent de cinéaste d’Aronofsky, rusé comme un cygne noir, et de son interprète principale, sont tels que vous êtes peu à peu happés, le souffle suspendu comme devant un pas de danse époustouflant.
Black swan à l’image de l’histoire qu’il conte (le verbe conter n’est d’ailleurs pas ici innocent puisqu’il s’agit ici d’un conte, certes funèbre) est un film gigogne, double et même multiple. Jeu de miroirs entre le ballet que Thomas met en scène et le ballet cinématographique d’Aronofsky. Entre le rôle de Nina dans le lac des cygnes et son existence personnelle. Les personnages sont ainsi à la fois doubles et duals : Nina que sa quête de perfection aliène mais aussi sa mère qui la pousse et la jalouse tout à la fois ou encore Thomas pour qui, tel un Machiavel de l’art, la fin justifie les moyens.
Aronofsky ne nous « conte » donc pas une seule histoire mais plusieurs histoires dont le but est une quête d’un idéal de beauté et de perfection. La quête de perfection obsessionnelle pour laquelle Nina se donne corps et âme et se consume jusqu’à l’apothéose qui, là encore, se confond avec le film qui s’achève sur un final déchirant de beauté violente et vertigineuse, saisissant d’émotion.
Par une sorte de mise en abyme, le combat (qui rappelle celui de The Wrestler) de Nina est aussi celui du cinéaste qui nous embarque dans cette danse obscure et majestueuse, dans son art (cinématographique) qui dévore et illumine (certes de sa noirceur) l’écran comme la danse et son rôle dévorent Nina. L’art, du cinéma ou du ballet, qui nécessite l'un et l'autre des sacrifices. Le fond et la forme s’enlacent alors pour donner cette fin enivrante d’une force poignante à l’image du combat que se livrent la maîtrise et l’abandon, l’innocence et le vice.
Quel talent fallait-il pour se montrer à la hauteur de la musique de Tchaïkovski pour nous faire oublier que nous sommes au cinéma, dans une sorte de confusion fascinante entre les deux spectacles, entre le ballet cinématographique et celui dans lequel joue Nina. Confusion encore, cette fois d’une ironie cruelle, entre l'actrice Winona Ryder et son rôle de danseuse qui a fait son temps. Tout comme, aussi, Nina confond sa réalité et la réalité, l’art sur scène et sur l’écran se confondent et brouillent brillamment nos repères. Cinéma et danse perdent leur identité pour en former une nouvelle. Tout comme aussi la musique de Clint Mansell se mêle à celle de Tchaïkovski pour forger une nouvelle identité musicale.
La caméra à l’épaule nous propulse dans ce voyage intérieur au plus près de Nina et nous emporte dans son tourbillon. L’art va révéler une nouvelle Nina, la faire grandir, mais surtout réveiller ses (res)sentiments et transformer la petite fille vêtue de rose et de blanc en un vrai cygne noir incarné par une Natalie Portman absolument incroyable, successivement touchante et effrayante, innocente et sensuelle, qui réalise là non seulement une véritable prouesse physique (surtout sachant qu’elle a réalisé 90% des scènes dansées !) mais surtout la prouesse d’incarner deux personnes (au moins...) en une seule.
Un film aux multiples reflets et d’une beauté folle, au propre comme au figuré, grâce à la virtuosité de la mise en scène et de l’interprétation et d’un jeu de miroirs et mise(s) en abyme. Une expérience sensorielle, une danse funèbre et lyrique, un conte obscur redoutablement grisant et fascinant, sensuel et oppressant dont la beauté hypnotique nous fait perdre (à nous aussi) un instant le contact avec la réalité pour atteindre la grâce et le vertige.
Plus qu’un film, une expérience à voir et à vivre impérativement (et qui en cela m’a fait penser à un film certes a priori très différent mais similaire dans ses effets : L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot) et à côté duquel le Somewhere de Sofia Coppola qui lui a ravi le lion d’or à Venise apparaît pourtant bien fade et consensuel...