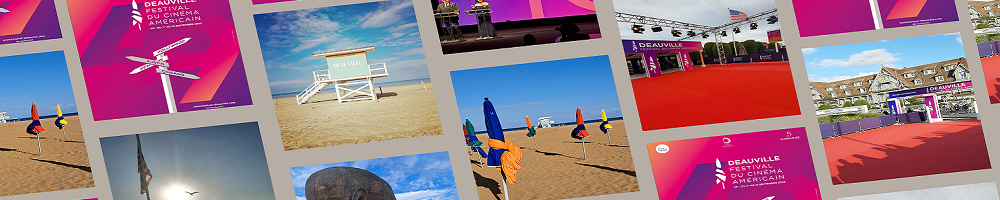Les 100 ans des Planches. Les 50 ans du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Cette année, le cœur de Deauville est en fête ! Qui aurait prédit une destinée aussi éblouissante à ce festival quand, en 1975, Lionel Chouchan et André Halimi, sous l'impulsion de Michel d'Ornano, alors Maire de Deauville, et de Lucien Barrière, alors Président du groupe éponyme, ont eu l’idée de le créer ? Deux ans après sa création, Deauville pouvait déjà s’enorgueillir de la présence de Gregory Peck, Sydney Pollack, et d’un jeune acteur nommé Harrison Ford. Les hommages et les nombreuses stars qui foulèrent ses planches désormais centenaires rendirent ce festival célèbre dans le monde entier : Vincente Minelli (1977), Sydney Pollack (1977, 2006), Kirk Douglas (1978, 2020), Clint Eastwood (1980, 2000), Lauren Bacall (1989), Michael Douglas (1998, 2007 et 2013), Al Pacino (1999), Robin Williams (1999), James Ivory (2003), Francis Ford Coppola (2004), Steven Spielberg (2004), Andy Garcia (2009), Liam Neeson (2012), Harvey Keitel (2012), John Williams (2012), Cate Blanchett (2013), Terrence Malick (2015), Morgan Freeman (2018). Et tant d’autres… Le sublime écrin pour cet évènement qu’est le CID qui l’accueillit dès 1992 et la création de la compétition de films indépendants en 1995 le firent entrer dans la légende et dans le cœur des cinéphiles. Ce festival n’est en effet pas seulement la vitrine des films des studios qu’il fut à ses débuts, il est aussi désormais l’antre des cinéphiles, et un découvreur indéniable de talents. Le premier jury, présidé par le réalisateur Andrei Konchalovsky, récompensa ainsi Tom Di Cillo pour Ça tourne à Manhattan (1995). Lui succédèrent notamment des films aussi marquants que Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze (1999), Collision de Paul Haggis (2005), Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris (2006), Take shelter de Jeff Nichols (2011), Whiplash de Damien Chazelle (2014), Aftersun de Charlotte Wells (2022). Ce cinquantième anniversaire s’annonce grandiose puisque les récipiendaires des Deauville Talent Awards 2023, absents pour cause de grève à Hollywood, sont d’ores et déjà annoncés…sans compter les très nombreuses surprises qui marqueront l’évènement !
J'aurai le plaisir de couvrir ce Festival du Cinéma Américain de Deauville 2024, comme chaque année, un festival auquel j'assiste depuis tant d'années qu'il serait indécent de les comptabiliser. Deauville restera mon premier festival de cinéma, celui dont je n'ai manqué une seule édition, celui qui a exacerbé ma passion pour le septième art et les festivals de cinéma. Evidemment, je ne pouvais donc pas manquer son cinquantième anniversaire.
Vous pourrez ainsi retrouver mon interview dans le prochain magazine Normandie Prestige dans lequel je vous parle de ma passion pour ce festival. Dans ce même magazine, vous pourrez aussi lire mon bilan de l'édition 2023 du Festival du Cinéma Américain, à retrouver aussi sur Inthemoodfordeauville.com, ainsi que mes articles sur les précédentes éditions du festival. Vous pouvez lire le magazine Normandie Prestige en ligne sur Calameo, ici.
Après avoir eu l'honneur d'être sélectionnée au Festival Livres et Musiques en mai dernier et de dédicacer dans le cadre majestueux des Franciscaines, j'aurai aussi le plaisir de dédicacer de nouveau mon roman La Symphonie des rêves à Deauville, pendant ce festival. Je vous en dirai bientôt plus.
De ces 50 ans du Festival du Cinéma Américain de Deauville, nous connaissons pour l'heure :
- l'affiche,
- les dates (6 au 15 septembre),
- l'invité d'honneur : Michael Douglas.

- le nom du Président du jury : Benoît Magimel
-la composition du jury de la révélation : Alice Belaïdi – Présidente (comédienne), Emma Benestan (réalisatrice & scénariste), Salim Kechiouche (comédien, réalisateur & scénariste), Iris Kaltenbäck (réalisatrice & scénariste), Karidja Touré (comédienne)

Alice Belaïdi © Andreas Rentz / Salim Kechiouche © Vincent Pesci / Karidja Touré © Thomas lemarchand
- Un hommage à Frederick Wiseman
- Le Prix d’Ornano-Valenti sera officiellement remis lors de la cérémonie du Palmarès du Festival du cinéma américain de Deauville, il sera attribué à RABIA de Mareike Engelhardt, qui sortira en salles le 27 novembre 2024.
-Le Festival rendra hommage à James Gray. James Gray sera présent à Deauville pour une conversation exceptionnelle lundi 9 septembre. L’intégralité de sa filmographie sera également projetée pendant le festival.
Retrouvez mes critiques des films suivants en cliquant sur leurs titres :


Les organisateurs ont également annoncé que, pour son cinquantième anniversaire, le Festival du cinéma américain de Deauville mettrait en avant une sélection de 50 films qui ont changé nos regards sur le monde. 50 films américains, de INTOLERANCE de D. W. Griffith (1916) à ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD de Quentin Tarantino (2019), "sélectionnés en toute subjectivité pour leur manière d’avoir profondément façonné le 7e art au cours de son premier siècle d’existence, tant par leur technique, leur mise en scène, leur inventivité, leur audace, leur contenu et toutes les idées diverses qu’ils ont pu projeter."

MULHOLLAND DRIVE de David Lynch © StudioCanal
À cette occasion, Deauville étend sa collaboration avec le cinéma Morny pour offrir aux festivaliers une deuxième salle de projection, où les films seront présentés par des talents ou des professionnels de l'industrie. Spécialement consacrée à cette rétrospective exceptionnelle, cette nouvelle salle incarnera un vaste panorama du cinéma américain, où les regards se croisent dans un miroir qui renvoie à notre passé, accompagne notre présent et prédit notre avenir.
Voici la liste des 50 films en questions que je vous recommande tous. Je vous propose par ailleurs la critique de l'un d'entre eux, en bas de cet article : Casablanca de Michael Curtiz.
LISTE DES 50 FILMS
1916 INTOLÉRANCE de D. W. Griffith
1927 L’AURORE de Friedrich Wilhelm Murnau
1932 FREAKS de Tod Browning
1939 AUTANT EN EMPORTE LE VENT de Victor Fleming
1940 LE DICTATEUR de Charlie Chaplin
1941 CITIZEN KANE de Orson Welles
1942 CASABLANCA de Michael Curtiz
1942 TO BE OR NOT TO BE d’Ernst Lubitsch
1946 LA VIE EST BELLE de Frank Capra
1950 OUTRAGE d’Ida Lupino
1950 EVE… de Joseph L. Mankiewicz
1955 LA NUIT DU CHASSEUR de Charles Laughton
1956 LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT de John Ford
1959 AUTOPSIE D'UN MEURTRE de Otto Preminger
1959 RIO BRAVO de Howard Hawks
1959 MIRAGE DE LA VIE de Douglas Sirk
1959 CERTAINS L’AIMENT CHAUD de Billy Wilder
1960 PSYCHOSE de Alfred Hitchcock
1961 WEST SIDE STORY de Robert Wise & Jerome Robbins
1967 BONNIE AND CLYDE de Arthur Penn
1968 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE de Stanley Kubrick
1969 EASY RIDER de Dennis Hopper
1969 LA HORDE SAUVAGE de Sam Peckinpah
1970 WANDA de Barbara Loden
1972 LE PARRAIN de Francis Ford Coppola
1972 CABARET de Bob Fosse
1973 L’EXORCISTE de William Friedkin
1974 UNE FEMME SOUS INFLUENCE de John Cassavetes
1975 VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU de Milos Forman
1976 NETWORK de Sidney Lumet
1976 CARRIE AU BAL DU DIABLE de Brian de Palma
1976 TAXI DRIVER de Martin Scorsese
1977 LA GUERRE DES ETOILES de Georges Lucas
1978 VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER de Michael Cimino
1982 E.T, l’EXTRA-TERRESTRE de Steven Spielberg
1982 RAMBO de Ted Kotcheff
1984 TERMINATOR de James Cameron
1989 DO THE RIGHT THING de Spike Lee
1990 EDWARD AUX MAINS D'ARGENT de Tim Burton
1992 IMPITOYABLE de Clint Eastwood
1997 BOOGIE NIGHTS de Paul Thomas Anderson
1999 MATRIX des Wachowski
1999 VIRGIN SUICIDES de Sofia Coppola
2001 MULHOLLAND DRIVE de David Lynch
2003 ELEPHANT de Gus Van Sant
2007 ZODIAC de David Fincher
2010 INCEPTION de Christopher Nolan
2012 ZERO DARK THIRTY de Kathryn Bigelow
2015 SPOTLIGHT de Tom McCarthy
2019 ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD de Quentin Tarantino
Critique de ONE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD de Quentin Tarantino
Critique de CASABLANCA de Michael Curtiz

On ne présente plus Casablanca ni Rick Blaine (Humphrey Bogart), le mystérieux propriétaire du bigarré Café Américain. Nous sommes en 1942, à Casablanca, là où des milliers de réfugiés viennent et échouent des quatre coins de l’Europe, avec l’espoir fragile d’obtenir un visa pour pouvoir rejoindre les Etats-Unis. Casablanca est alors sous le contrôle du gouvernement de Vichy. Deux émissaires nazis porteurs de lettres de transit sont assassinés. Ugarte (Peter Lorre), un petit délinquant, les confie à Rick alors qu’il se fait arrêter dans son café. C’est le capitaine Renault (Claude Rains), ami et rival de Rick, qui est chargé de l’enquête tandis qu’arrive à Casablanca un résistant du nom de Victor Laszlo (Paul Henreid). Il est accompagné de sa jeune épouse : la belle Ilsa (Ingrid Bergman). Rick reconnaît en elle la femme qu’il a passionnément aimée, à Paris, deux ans auparavant…
Casablanca est un film qui contient plusieurs films, plusieurs histoires potentielles esquissées ou abouties, plusieurs styles et tant de destins qui se croisent.
Plusieurs films d’abord. Casablanca est autant le portrait de cette ville éponyme, là où tant de nationalités, d’espoirs, de désespoirs se côtoient, là où l’on conspire, espère, meurt, là où la chaleur et l’exotisme ne font pas oublier qu’un conflit mondial se joue et qu’il est la seule raison pour laquelle des êtres si différents se retrouvent et parfois s’y perdent.
C’est ensuite évidemment l’histoire de la Résistance, celle de la collaboration, l’Histoire donc.
Et enfin une histoire d’amour sans doute une des plus belles qui ait été écrite pour le cinéma. De ces trois histoires résultent les différents genres auxquels appartient ce film : vibrante histoire d’amour avant tout évidemment, mais aussi comédie dramatique, film noir, mélodrame, thriller, film de guerre.
Peu importe le style auquel il appartient, ce qui compte c’est cette rare alchimie. Cette magie qui fait que, 83 ans après sa sortie, ce film est toujours aussi palpitant et envoûtant.
L’alchimie provient d’abord du personnage de Rick, de son ambiguïté. En apparence hautain, farouche individualiste, cynique, velléitaire, amer, il se glorifie ainsi de « ne jamais prendre parti », de « ne prendre de risque pour personne » et dit qu’ « alcoolique est sa nationalité » ; il se révèle finalement patriote, chevaleresque, héroïque, déterminé, romantique. Evidemment Humphrey Bogart avec son charisme, avec son vieil imper ou son costume blanc (qui reflètent d’ailleurs le double visage du personnage), sa voix inimitable, sa démarche nonchalante, ses gestes lents et assurés lui apporte un supplément d’âme, ce mélange de sensibilité et de rudesse qui n’appartient qu’à lui. Un personnage aux mille visages, chacun l’appelant, le voyant aussi différemment. Auparavant surtout connu pour ses rôles de gangsters et de détectives, Humphrey Bogart était loin d’être le choix initial (il fut choisi après le refus définitif de George Raft) tout comme Ingrid Bergman d’ailleurs (Michèle Morgan, notamment, avait d’abord été contactée), de même que le réalisateur Michael Curtiz n’était pas le choix initial de la Warner qui était William Wyler. On imagine désormais mal comment il aurait pu en être autrement tant tous concourent à créer cette alchimie…
Cette alchimie provient évidemment du couple qu’il forme avec Ingrid Bergman qui irradie littéralement l’écran, fragile, romanesque, nostalgique, mélancolique notamment grâce à une photographie qui fait savamment briller ses yeux d’une tendre tristesse. Couple romantique par excellence puisque leur amour est rendu impossible par la présence du troisième personnage du triangle amoureux qui se bat pour la liberté, l’héroïque Victor Laszlo qui les place face à de cruels dilemmes : l’amour ou l’honneur. Leur histoire personnelle ou l’Histoire plus grande qu’eux qui tombent « amoureux quand le monde s’écroule ». L’instant ou la postérité.
Et puis il y a tous ces personnages secondaires : Sam (Dooley Wilson), le capitaine Renault, …, chacun incarnant un visage de la Résistance, de la collaboration ou parfois une attitude plus ambiguë à l’image de ce monde écartelé, divisé dont Casablanca est l’incarnation.
Concourent aussi à cette rare alchimie ces dialogues, ciselés, qui, comme le personnage de Rick oscillent entre romantisme noir et humour acerbe : « de tous les bistrots, de toutes les villes du monde c’est le mien qu’elle a choisi ». Et puis ces phrases qui reviennent régulièrement comme la musique de Sam, cette manière nonchalante, presque langoureuse que Rick a de dire « Here’s looking at you, kid » .
Et comme si cela n’était pas suffisant, la musique est là pour achever de nous envoûter. Cette musique, réminiscence de ces brefs instants de bonheur à Paris, entre Rick et Ilsa, à La Belle Aurore, quand l’ombre ne s’était pas encore abattue sur le destin et qu’il pouvait encore être une « belle aurore », ces souvenirs dans lesquels le « Play it again Sam » les replonge lorsque Illsa implore Sam de rejouer ce morceau aussi célèbre que le film : As time goes by ( la musique est signée Max Steiner mais As time goes by a été composée par Herman Hupfeld en 1931 même si c’est Casablanca qui a contribué à sa renommée).
Et puis il y a la ville de Casablanca d’une ensorcelante incandescence qui vibre, grouille, transpire sans cesse de tous ceux qui s’y croisent, vivent de faux-semblants et y jouent leurs destins : corrompus, réfugiés, nazis, collaborateurs… .
Des scènes d’anthologie aussi ont fait entrer ce film dans la légende comme ce combat musical, cet acte de résistance en musique (les partisans des Alliés chantant la Marseillaise couvrant la voix des Allemands chantant Die Wacht am Rhein, et montrant au détour d’un plan un personnage changeant de camp par le chant qu’il choisit) d’une force dramatique et émotionnelle incontestable. Puis évidemment la fin que les acteurs ne connaissaient d’ailleurs pas au début et qui fut décidée au cours du tournage, cette fin qui fait de Casablanca sans doute une des trois plus belles histoires d’amour de l’histoire du cinéma. Le tournage commença ainsi sans scénario écrit et Ingrid Bergman ne savait alors pas avec qui son personnage partirait à la fin, ce qui donne aussi sans doute à son jeu cette intrigante ambigüité. Cette fin ( jusqu’à laquelle l’incertitude est jubilatoire pour le spectateur) qui rend cette histoire d’amour intemporelle et éternelle. Qui marque le début d’une amitié et d’un engagement (le capitaine Renault jetant la bouteille de Vichy, symbole du régime qu’il représentait jusqu’alors) et est clairement en faveur de l’interventionnisme américain, une fin qui est aussi un sacrifice, un combat pour la liberté qui subliment l’histoire d’amour, exhalent et exaltent la force du souvenir (« nous aurons toujours Paris ») et sa beauté mélancolique.
La réalisation de Michael Curtiz est quant à elle élégante, sobre, passant d’un personnage à l’autre avec beaucoup d’habileté et de fluidité, ses beaux clairs-obscurs se faisant l’écho des zones d’ombre des personnages et des combats dans l’ombre et son style expressionniste donnant des airs de film noir à ce film tragique d’une beauté déchirante. Un film qui comme l’amour de Rick et Ilsa résiste au temps qui passe.
Le tout concourant à ce romantisme désenchanté, cette lancinance nostalgique et à ce que ce film soit régulièrement classé comme un des meilleurs films du cinéma mondial. En 1944, il fut ainsi couronné de trois Oscars (meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur film) et l’American Film Institute, en 2007, l’a ainsi classé troisième des cents meilleurs films américains de l’Histoire derrière l’indétrônable Citizen Kane et derrière Le Parrain.
Le charme troublant de ce couple de cinéma mythique et le charisme ensorcelant de ceux qui les incarnent, la richesse des personnages secondaires, la cosmopolite Casablanca, la musique de Max Steiner, la voix de Sam douce et envoûtante chantant le nostalgique As time goes by, la menace de la guerre lointaine et si présente, la force et la subtilité du scénario (signé Julius et Philip Epstein d’après la pièce de Murray Burnett et Joan Alison Everybody comes to Rick’s), le dilemme moral, la fin sublime, l’exaltation nostalgique et mélancolique de la force du souvenir et de l’universalité de l’idéalisme (amoureux, résistant) et du combat pour la liberté font de ce film un chef d’œuvre…et un miracle quand on sait à quel point ses conditions de tournage furent désastreuses.
La magie du cinéma, tout simplement, comme le dit Lauren Bacall : « On a dit de Casablanca que c’était un film parfait évoquant l’amour, le patriotisme, le mystère et l’idéalisme avec une intégrité et une honnêteté que l’on trouve rarement au cinéma. Je suis d’accord. Des générations se plongeront dans le drame du Rick’s Café Américain. Et au fil du temps, le charme de Casablanca, de Bogey et de Bergman continuera à nous ensorceler. C’est ça, la vraie magie du cinéma ».
Un chef-d’œuvre à voir absolument. A revoir inlassablement. Ne serait-ce que pour entendre Sam (Dooley Wilson) entonner As time goes by et nous faire chavirer d’émotion.