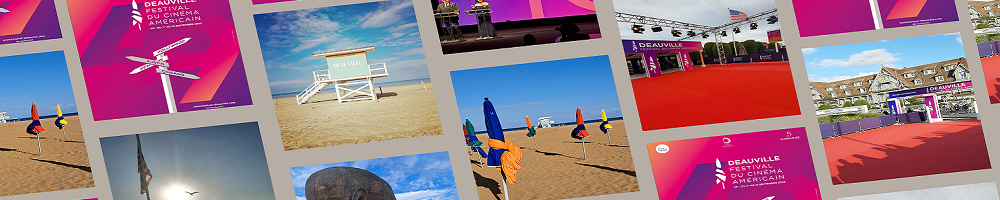Katie, une jeune serveuse au cœur d’or, habite dans le Sud-Ouest américain et rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premières amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie facile, et ce sont ceux qu'elle aime le plus au monde qui mettront à rude épreuve la ténacité et l’innocence qui la caractérisent. INTERPRÉTATION Olivia Cooke (Katie), Christopher Abbott (Bruno), Mireille Enos (Tracey), Mary Steenburgen (Maybelle), Jim Belushi (Bear), Chris Lowell (Dirk), Nate Corddry (Mr. Daniels), Natasha Bassett (Sara), Keir Gilchrist (Matty)
Katie, avec ses boucles blondes juvéniles, son visage souriant, ses grands yeux brillants et naïfs, sa panoplie rose, elle aussi rêve d’un ailleurs plus coloré malgré l’âpreté de l’univers dans lequel elle évolue. Katie elle aussi continue à croire en l’ « American dream » même si elle en symbolise l’échec. Oui, elle croit Katie. Elle croit dur comme fer qu’elle va s’en sortir. Que les lendemains seront meilleurs. Elle croit en la bonté de l’être humain, aussi. La réussite tient avant tout dans ce personnage atypique, attachant (encore), bienveillant, généreux, optimiste envers et contre tout et tous. Katie aussi est un contraste vivant. Elle vit dans un mobile home avec une mère qui passe son temps à boire et à batifoler avec le mari de la voisine. Katie vend son corps. Elle rêve pourtant du coup de foudre et est persuadée de de trouver le grand amour en la personne de celui qu’elle considère comme « le plus bel homme qu’elle ait jamais vu » (Christopher Abbott également en compétition dans « Sweet Virginia », sorte d’armoire à glace impassible qui dissimule un sombre passé et qui a pour seul objectif dans la vie d’ « éviter les ennuis »). Elle vit au milieu de nulle part, dans un lieu anachronique et sans espoir, baignée d’une lumière d’été, d’une douceur mensongère. Elle rêve de refaire sa vie à San Francisco. Olivia Cooke incarne brillamment (elle EST même) cette candide jeune femme au visage enfantin et donne corps et âme à la saisissante dichotomie entre ses rêves et la réalité, sa vie sordide et la bienveillante naïveté avec laquelle elle la regarde, et avec laquelle elle regarde ceux qui l’entourent, allant jusqu’à se sacrifier pour eux. Le dénouement est d’une émotion et d’une force saisissantes et étourdissantes. Celles du fracas entre le rêve et la réalité. Choc brutal et vertigineux. Avant l’au revoir salutaire. Un personnage qui vous « hante » longtemps après le générique de fin.